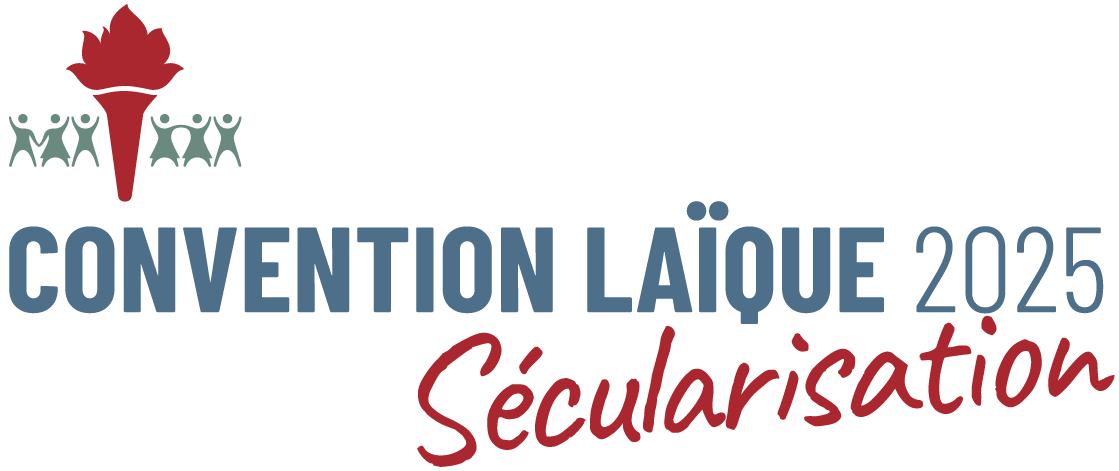Comme face à de nombreuses autres libertés, l’Église, qui détenait le pouvoir politique et le monopole moral de nos sociétés, exerçait sur les libertés d’expression, artistique et académique une censure et une contrainte dont l’intensité a diminué au fur et à mesure que la sécularisation avançait.
Aujourd’hui, les libertés d’expression, artistique et académique sont heureusement des libertés garanties par notre législation et l’Église n’a officiellement aucun pouvoir d’interdire ou de censurer quelque expression de ces libertés. L’État est le seul à même de statuer sur une restriction proportionnée de ces libertés par rapport à d’autres droits ou libertés fondamentales.
Cependant, les institutions religieuses n’ont pas renoncé à leur pouvoir d’influence et à leur volonté de restriction de ces libertés lorsqu’elles considèrent que l’exercice qui en est fait porte atteinte à leur morale ou à leurs dogmes. Elles contestent ainsi le blasphème, les caricatures religieuses, l’enseignement du concept du genre, etc., car ces questions s’opposent à leur conception de vie, à leurs croyances.
Si dans un État de droit, la liberté de religion et de conviction – dont découle notamment la liberté d’expression – est protégée, elle ne permet pas de contraindre autrui d’adhérer à ses propres convictions ou de limiter l’exercice des libertés d’autrui de manière arbitraire. L’influence des institutions religieuses et plus largement des différentes conceptions de vie est cadrée par la loi et ne peut pas s’exprimer au-dehors de celle-ci: pas question de (faire) interdire un discours, une œuvre, un cours simplement car celui-ci exprimerait d’autres valeurs que celles auxquelles une personne adhère. Le principe de sécularisation permet de laisser entre les mains de l’État la mise en balance entre les libertés concurrentes pour que celles-ci soient préservées de la manière la plus large possible et ne puissent être l’objet d’aucune pression indue.
Remarque: il convient de faire une nette différence entre la liberté d’expression et la liberté académique, dans la mesure où une dimension scientifique est présente dans l’enseignement académique. Liberté académique ne signifie pas que l’on admettrait que l’enseignant est libre de diffuser ses propres opinions ou croyances en dehors de ce cadre scientifique. La liberté académique ne doit s’entendre que dans la possibilité d’explorer tous les sujets de la connaissance humaine au moyen de la méthode scientifique.