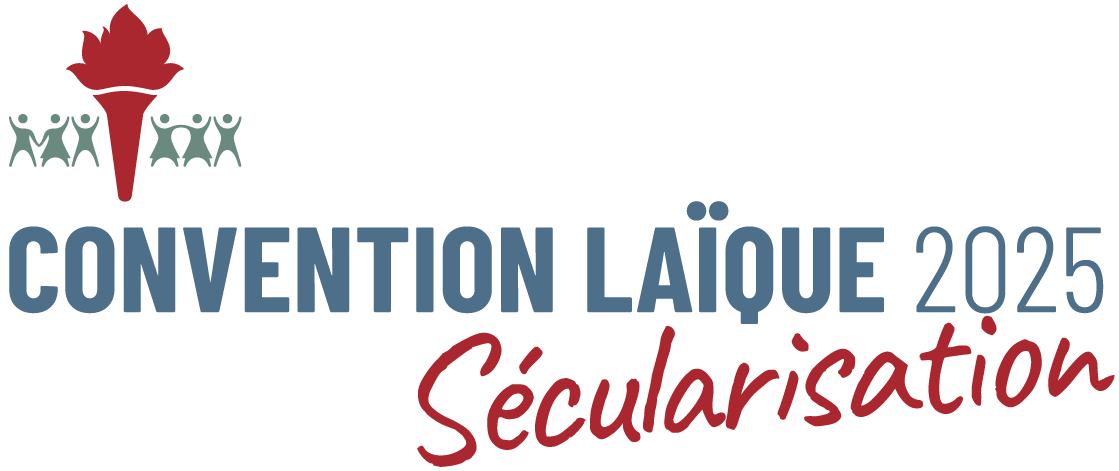Le principe de laïcité vise l’émancipation des citoyennes et des citoyens en leur garantissant l’exercice de leurs droits et libertés indépendamment de toute appartenance philosophique ou religieuse. L’impartialité de l’État qui découle de ce principe doit assurer qu’aucune conviction religieuse ou philosophique ne prend le pas sur une autre dans les décisions et politiques mises en œuvre.
Un retour du religieux
Pourtant, force est de constater aujourd’hui un retour du religieux dans la sphère publique et une expression de plus en plus décomplexée de revendications dogmatiques ou obscurantistes. Souvent d’ailleurs, ce retour en arrière ou les attaques frontales contre des fondamentaux que nous pensions acquis s’observent parallèlement au gain d’influence de populismes conservateurs en politique. Pensons seulement à l’Amérique de Trump ou, plus près de chez nous, à la Hongrie de Orban.
Une Convention laïque consacrée à la sécularisation
Le Centre d’Action Laïque estime que la situation est très préoccupante et qu’elle mérite d’être analysée globalement, plutôt que secteur par secteur. Derrière ce retour du religieux, c’est un recul des droits et libertés qui s’annonce. Aussi a-t-il décidé de consacrer sa prochaine Convention à la question de la sécularisation.
Il s’agira pour le mouvement laïque de dresser l’état des lieux du retour du religieux dans quantité de domaines de la vie en société et de dresser les priorités d’actions pour mettre un terme à cette évolution inquiétante. Il s’agira également d’interroger, dans une démarche libre-exaministe, l’intention des institutions religieuses quant à l’organisation de la démocratie et la citoyenneté.
En effet, orienter l’évolution de notre société en fonction de dogmes tirés d’une conviction particulière met à mal l’universalisme des droits et des libertés. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, indépendamment de leurs particularités culturelles, philosophiques ou religieuses, bénéficient des mêmes droits et devoirs. Perdre cette balise fondamentale revient à privilégier l’intérêt particulier sur l’intérêt collectif, ce qui ouvre la porte à une désagrégation du corps social.
Ce questionnement n’a bien entendu aucune vocation anti-religieuse. Le mouvement laïque défend fermement la liberté de conscience qui inclut la liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de conviction. Mais simplement, nul ne doit se voir imposer une loi autre que la loi civile décidée démocratiquement.
3 thématiques
En préparation de cette Convention, le Centre d’action laïque a sollicité ses militants, ses sympathisants et, d’une façon générale, le grand public pour identifier les domaines de la vie société et les thématiques sur lesquels il devrait travailler en priorité lors de la Convention pour faire face à cet enjeu.
Sont ressorties de cette consultation du mouvement laïque, trois thématiques identifiées comme prioritaires:
Aller plus loin
Sécularisation: principe et cadre légal
La sécularisation est un terme dérivé du latin saecularis, séculier, profane, lui-même dérivé de saeculum, ce qui appartient au siècle, c’est-à-dire au monde laïc et non à l’Église.
Le besoin d’égalité de traitement des citoyens dans l’après Révolution française se traduit par une sécularisation de l’État, dont les provinces belges, où sont désormais confiées aux autorités profanes des fonctions auparavant aux mains des autorités religieuses.
Cette diminution de l’influence des religions dans la sphère publique ne signifie toutefois pas qu’elles sont aujourd’hui muselées. Dans un État sécularisé, les convictions et religions peuvent faire entendre leur voix, se rassembler pour agir, etc.
La sécularisation est d’abord une méthode pour instaurer l’impartialité des pouvoirs publics, c’est-à-dire le respect du traitement égal dû à chacun, indépendamment des convictions ou religions.
En n’exprimant aucune référence ou préférence pour une conception de vie et en interdisant toute forme d’ingérence des autorités religieuses dans les décisions publiques, l’État impartial garantit à chaque individu la possibilité d’exercer ses libertés et de revendiquer ses droits en fonction de son propre cadre de référence et de ses propres valeurs, comme organiser ses relations sociales en toute liberté (droit à la vie privée et familiale) ou se rassembler (liberté d’association ou de réunion) sur base de convictions partagées.
Dès la naissance de la Belgique, la Constitution de 1831 consacre la sécularisation du l’institution du mariage, qui était auparavant la prérogative de l’Église. Le mariage devient une institution publique régie par des dispositions légales, et non plus selon des dogmes catholiques. Mieux encore, le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux, et est le seul valable aux yeux de l’État: la bénédiction nuptiale (mariage religieux) ne peut produire aucune conséquence juridique opposable aux tiers ou à l’État.
Très libérale pour l’époque, la Constitution belge considère religions et convictions comme des libertés privées dont l’État doit garantir l’exercice pacifique et égalitaire. Ce principe de neutralité de l’État participe au processus de sécularisation de l’État. Un très, très, lent processus. Car dans les faits, l’objectif de la sécularisation, l’impartialité de l’État belge, n’est toujours pas acquise. Or, celle-ci est seule garante de l’aboutissement du principe d’égalité et de non-discrimination comme de la protection la plus étendue et la plus ferme de tous les droits fondamentaux, dont la liberté de conscience et de convictions.
Les limites de celles-ci nous sautent aux yeux, quand on assiste aux manipulations de masse opposant précisément la liberté d’expression religieuse ou extrémiste à la garantie des droits fondamentaux.
Le principe de la sécularisation de l’État vise avant tout à garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens et leur accès égalitaire aux services publics.
La lutte contre les opposants à la sécularisation est indispensable, mais secondaire. Elle n’est qu’un des moyens pour soutenir notre objectif d’un État réellement impartial.
En tant que mouvement laïque, nos valeurs sont en effet intimement liées à l’impartialité de l’État dont la sécularisation est la mise en œuvre. Elle est au cœur de nombreux plaidoyers laïques et rencontre nos valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité, mais aussi de promotion du libre-examen. Le respect de l’autonomie personnelle va de pair avec la défense de la démocratie et de l’État de droit.
Sécularisation: enjeux
L’État doit être impartial, ou à tout le moins neutre. Mais comment?
Du point de vue d’autorités religieuses hégémoniques, le respect des prescrits religieux garanti dans la sphère privée n’est pas suffisant. Leur volonté de peser sur les corpus législatifs est réelle: interruption volontaire de grossesse (IVG), abattage rituel, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), euthanasie, cours de philosophie et citoyenneté (CPC)… Le point commun de ces pressions religieuses – toutes obédiences confondues – sur l’impartialité de l’État, est de vouloir empêcher les citoyens de choisir, de décider librement de leur existence, de leur mort, de leur rapport à la sexualité, de leur vie tout simplement.
Comment l’État peut-il garantir les droits fondamentaux des citoyens d’autres convictions ou religions, quand des parlementaires votent majoritairement en faveur de prescrits religieux limitant la liberté de choix, ou quand des groupes de pression s’opposent violemment à des politiques publiques au nom du respect de leur religion?
Les autorités publiques sont tenues de faire preuve de neutralité dans la mise en œuvre des lois et réglementations. Mais cette neutralité n’est pas suffisante pour garantir l’impartialité de l’État. La preuve par le combat mené contre la neutralité d’apparence des agents de la fonction publique, au seul bénéfice du port du voile islamique. Il s’agirait alors effectivement d’un particularisme d’ordre religieux dans l’appareil de l’État, ce qui ne saurait se concevoir ni dans le respect du principe de neutralité et encore moins d’impartialité.
Au-delà des structures de l’État, la sécularisation permet de garantir un enseignement public neutre, bien que l’influence des réseaux confessionnels demeure forte, notamment dans l’organisation des cours de religion. Elle favorise également des politiques de santé publique basées sur les droits des patients, malgré la résistance de certains acteurs religieux sur des questions comme l’IVG et l’euthanasie. L’émancipation des femmes a été renforcée par la sécularisation, qui a permis leur droit au divorce, à l’autonomie financière et au contrôle de leur corps. De même, les droits des personnes LGBTQIA+ ont progressé grâce à une société détachée des dogmes religieux, favorisant la liberté affective et sexuelle. La sécularisation protège aussi contre le racisme et la xénophobie en instaurant des lois anti-discrimination et en réduisant les tensions entre groupes religieux. Concernant l’accompagnement des personnes, elle a permis l’instauration de structures d’accompagnement moral neutres, affranchies des dogmes religieux. S’agissant de la lutte contre la précarité, les logiques séculières ont fait émergée des politiques sociales qui repose sur une exigence humaniste de justice sociale plutôt que sur logique caritative confessionnelle. Concernant les migrations, la sécularisation assure une intégration fondée sur les droits humains plutôt que sur des critères religieux.
Cependant, des menaces demeurent: aujourd’hui un retour du religieux dans la sphère publique et une expression de plus en plus décomplexée de revendications dogmatiques ou obscurantistes. Souvent d’ailleurs, ce retour en arrière ou les attaques parfois frontales contre des fondamentaux que nous pensions acquis s’observent parallèlement au gain d’influence de populismes conservateurs en politique. Pensons seulement à l’Amérique de Trump ou, plus près de chez nous, à la Hongrie de Orban.
Cette situation préoccupante mérite d’être analysée et traitée globalement. Derrière ce retour du religieux, c’est un recul des droits et libertés qui s’annonce.
En effet, orienter l’évolution de notre société en fonction de dogmes tirés d’une conviction particulière met à mal l’universalisme des droits et des libertés. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, indépendamment de leurs particularités culturelles, philosophiques ou religieuses, bénéficient des mêmes droits et devoirs. Perdre cette balise fondamentale revient à privilégier l’intérêt particulier sur l’intérêt collectif, ce qui ouvre la porte à une désagrégation du corps social.